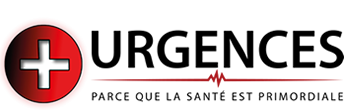L’hôpital psychiatrique de Bingerville traverse une crise sans
précédent. Les bâtiments et les matériels de travail sont vétustes. Les malades
n’ont aucun médicament. Conséquence, ils agressent au quotidien le personnel.
L’hôpital
psychiatrique de Bingerville a ouvert ses portes en 1962 après trois années de
construction. Le 18 février de cette même année, à 18 h30, il a reçu son premier malade. C’était
un prisonnier. A cette époque là, l’hôpital était un asile de fou qui ne
recevait que les prisonniers atteints de démence. Tout était beau et propre.
Les médecins, Européens à majorité, avaient
à leur disposition tout le matériel de travail nécessaire pour diagnostiquer
les maux et trouver des remèdes appropriés aux patients.
Quarante ans plus tard, beaucoup d’eau a coulé sous le pont. Les
choses ont énormément changé. De 15 hectares, l’hôpital a été ramené à la
portion congrue. Il s’étend maintenant sur moins de 3 ha ; les 12 autres ont
été vendus à des particuliers qui y ont érigé des exploitations agricoles et
des opérations immobilières. En plus des fous, l’hôpital accueille de nos jours
les dépressifs et toutes autres victimes de maladies mentales. Le rôle de
l’établissement est donc de les héberger, de les nourrir et surtout de leur
prodiguer les soins adéquats en vue de leur guérison. Fait notable, au fil des
années, les malades sont de plus en plus nombreux. Très sollicité, l’hôpital
psychiatrique de Bingerville est débordé et se retrouve incapable à faire face
aux nombreuses charges. Le matériel est vieillissant et le personnel
insuffisant. Malades et agents hospitaliers vivent le calvaire au quotidien,
loin des regards des hommes dits normaux.
Un calvaire au quotidien
L’hôpital psychiatrique de Bingerville n’a pas l’ambiance
habituelle des autres hôpitaux ordinaires avec les odeurs d’alcool 90° et
autres cris de bébés. Pas de médecin en blouse avec des stéthoscopes au cou,
pressés et préoccupés. Les patients ne sont pas assis en rang sur des bancs
comme dans les CHU. Ici, rien ne montre que vous êtes dans un hôpital. La cour
est propre, le gazon est bien tondu. Et les fleurs, au soleil, livrent leur
splendeur. Une ambulance neuve est stationnée dans la cour, loin d’une autre
datant de Mathusalem et qui figurerait à une belle place dans un musée. L’air
est si doux que quelques personnes se laissent emporter dans un sommeil sous
les cocotiers. A première vue, la vie semble belle ici. Vue de l’hôpital, la
ville de Bingerville s’étend à perte de vue avec la lagune qui la borde.
Une fois le vieillissant portail franchi, vous êtes
accueillis par les salutations des malades. « Bonjour, tu es joli. Donne-moi ton
journal », a
lancé une jeune malade. Ayant été avertis par des précédents visiteurs, nous
lui adressons un bonjour amical et continuons sans rien dire. La jeune dame persiste : « Tu es
trop beau pour être méchant. Pardon. Regarde, tu m’as hypnotisé par ta
beauté ». Soudain, une autre
fille sort de l’allée menant au pavillon Abhé devant le « Bureau des
entrées ». Dans sa course, elle chute violemment et se retrouve à plat ventre
étendue dans l’océan de poussière. Après quelques secondes, elle se relève et
se lance dans un monologue injurieux. A qui en veut-elle ? Difficile de
répondre. Un jeune homme fonce droit vers nous en proférant des diatribes dans
le vide. Une autre demoiselle chante sa joie de vivre. Son chant bien que
mélodieux semble déranger une autre patiente. Elle crie si fort que deux autres
malades supplient la cantatrice de mettre fin à son concert. Cette atmosphère
renforce le sentiment que nous sommes bien dans un monde à part.
Après les usages administratifs avec le directeur de
l’établissement, M. Kouangoua Bady Bertin, nous entamons une visite guidée avec
Mme Dosso, chef de personnel. Très tôt, elle nous prévient : « Faites
attention aux malades. A tout moment, ils peuvent pique des crises et vous
agresser ».
Première escale, le Pavillon Abhé Antoine (PAA), celui réservé aux
femmes. C’est en 2001 qu’il
a été baptisé ainsi en hommage à Dr Abhé Antoine, concepteur de l’hôpital. Le
PAA comprend deux compartiments de 4 blocs chacun. Et chaque bloc a 4 lits.
Théoriquement donc, le PAA dispose de 16 lits pour un total de 37 patientes. Il y règne une odeur
particulière. Les murs sont délabrés. Les
fils électriques pendant démontrent bien qu’il n’y a pas d’électricité. Les lits, en fer, feraient le bonheur
des amoureux des pièces de musée. Visiblement, ils exposent les usagers au
tétanos. Les matelas sont dans un état de délabrement très avancé. Les
toilettes, près des blocs, sont exigües et insalubres. Elles dégagent une odeur
spéciale qui se propage dans le secteur. Par la force des choses, cette odeur
est devenue le parfum des lieux. Non loin de là, sort de terre un hangar qui
servira bientôt d’abri aux patients. Ceux-ci s’occupent comme elles peuvent. On
remarque la présence de jeunes filles et d’une vieille, la cinquantaine
révolue. Assise, en face de l’isoloir, elle mange avec appétit son repas de midi.
Les autres, non encore servis, s’empressent de faire le rang pour recevoir leur
déjeuner, du riz accompagné de sauce aubergine et de poisson. L’appétit vorace
de la vieille femme démontre bien que son besoin était pressant. Mais, le bol
est si petit qu’on imagine aisément qu’elle ne fera qu’une bouchée de ce repas.
Parlant d’isoloir, il y en a deux. Mais, un seul est opérationnel.
Pourtant, c’est dans cette chambre que les médecins isolent les malades qui
piquent des crises. Mme Dosso nous conduits au bureau de Dr Diabaté. Joviale, cette dame est
installée dans un bureau triste. Quatre patients attendent au secrétariat. Dr
Diabaté, bien que submergée, nous réserve un accueil fraternel. Elle est
installée dans un bureau aux murs délabrés. Dans son dos, est planté un vieux
climatiseur. Au lieu de produire de l’air conditionné, cet appareil est devenu
un nid de cafards et d’araignées. Il ne fonctionne plus depuis plusieurs
années.
A sa gauche, un robinet de l’ère colonial se distingue dans ce
décor jauni par l’usure du temps. Dr Diabaté est le psychiatre chargée des
femmes. Elle n’a que sa volonté et son amour comme outil de travail. « Nous
travaillons dans des conditions difficiles », lance laconiquement la psychiatre.
Au-delà du matériel administratif, elle déplore plus le manque de médicament. « Nous
ne disposons plus de médicaments. Nous avons reçu 10 boîtes de Largatil. Or,
chaque patient a droit à 2 boîtes. Nos besoins en Haldol 5 mg sont énormes.
Mais, nous ne recevons que 40 boîtes, d’ 1 mg de surcroît », ajoute Dr Diakité. Ses plaintes nous
incitent à découvrir la pharmacie. Un détour dans un couloir, et nous voici en
face d’elle la pharmacie.
Une pharmacie vide
La gigantesque porte métallique qui, protège l’enceinte, nous a
laissé espérer voir une officine pleine de médicaments. Grosse erreur. La porte
s’ouvre, c’est un homme qui nous reçoit. Ce monsieur, malgré sa grande taille,
est englouti par ses propres papiers. Son bureau de quatre mètres carrés est
touffu de cartons vides de médicaments. Il sert à la fois de salle de stockage,
de caisse et de lieu d’exposition. Deux chaises sont placées autour d’une
petite table, signe que ce monsieur n’est pas le seul locataire. Les deux
hommes se font face dans un
amour professionnel. Aucun signe ne montre que nous somme dans une pharmacie.
Il y fait chaud, encore plus qu’au bureau de Dr Diakité. Le climatiseur grogne inutilement. Il ne produit pas
grand-chose comme air conditionné. Mais, « le pharmacien » s’est
accommodé de ce décor et semble nourrir l’illusion de disposer de médicaments.
Il sort un trousseau de clefs de son tiroir. « Vous
allez voir notre stock », laisse-t-il entendre. Nos yeux sont
rivés sur la porte. Elle s’ouvre et ce ne sont que des étagères vides qui
s’offrent à nous. « Voici ce que nous avons comme
médicaments, c’est-à-dire rien, » ironise-t-il. Si sur
certaines étagères, l’on aperçoit des seringues et autres paracétamol, celle
sur laquelle devait être posés les médicaments de la famille des neuroleptiques
est vide. « Etant en psychiatrie,
notre pharmacie devrait avoir plus de 85% de neuroleptiques. Malheureusement,
vous constatez que nous en manquons. C’est inadmissible. Nos besoins sont satisfaits à moins de 20%. Le drame, c’est que
même la pharmacie de la santé publique est en rupture »,
déplore Tano Kouadio Firmin, le gestionnaire.
Pourtant, dans les couloirs, sont collées des affiches annonçant
la gratuité des médicaments. « Lisez bien. J’ai écrit que les
médicaments disponibles sont gratuits. Mais, nous sommes en rupture, peut-on
encore parler de gratuité ? », ironise M. Tano. Nous
ressortons, et il referme « sa prison ». De la pharmacie, un couloir
nous conduit droit au dortoir des hommes, le pavillon Mangnan Pacha.
Des pachas pauvres
Ce local est un peu plus à l’extrémité. Il est entouré de champs
de manioc, de bananes et de
hautes herbes. Ce retrait ne traduit aucunement un désamour de la part des
gestionnaires. Les patients reçoivent le même traitement que les dames. Et, les
réalités sont les mêmes. Pis, les lits ne suffisant pas. Parmi les 48 patients,
certains sont contraints de dormir à même le sol. Sur la terrasse glaciale,
poussiéreuse et envahie par les moustiques, ces malades y trouvent tout de même
un doux sommeil. L’ambiance
ici est plus électrique que chez les dames. L’insalubrité est plus accrue. Dr
N’Dri Mathias, le médecin chef, est débordé.
Seul, il fait face à toutes les sollicitations. Son bureau est
dépourvu de toutes commodités techniques et mêmes administratives. « Je n’ai
même pas d’ordonnancier », laisse entendre le jeune médecin. Son
seul plaisir, c’est que son bureau donne sur la verdure des champs. Il bénéficie
donc d’un doux vent et des chants d’oiseaux, qui atténuent la température moite
dans laquelle il travaille. Les autres bureaux visités sont vides. « Les conditions de travail ne sont pas motivantes». Comme dans les
autres services, le manque de médicament est relevé. En compagnie du médecin,
nous arrivons dans le couloir où est servi le repas de midi. Et, là, Dr N’Dri
ne peut contenir sa colère. « Voyez-vous ce que nous servons comme
nourriture à nos patients. Ce n’est pas normal ». Il brandit un petit bol en caoutchouc
contenant du riz. Inutile de s’attendre à l’« Uncle Sam américain »
prisé dans les restaurants chics. D’ailleurs,
peu importe la qualité. « Riz, c’est riz », pourrait-on dire. « Avec
les médicaments, les patients ont de grands besoins en nourriture.
Malheureusement, nous leur servons juste de quoi ne pas mourir de faim. La
nourriture n’est pas équilibrée », indique Dr N’Dri.
Du côté de la cuisine, tout est fermé. « Les femmes sont parties. Elles reviendront dans l’après
midi pour faire le repas du soir »,
indique Mme Dosso, notre guide. Derrière des grilles, l’on aperçoit de
gigantesques marmites et plusieurs sacs de riz stockés sur des étagères.
Service social, un vrai cas social
L’hôpital psychiatrique dispose d’un service social. Son rôle
consiste à détecter les cas sociaux lors des consultations des médecins et les
prendre en charge durant leur séjour. Le service social assure un suivi à
domicile pour la réinsertion des malades. Quelle noble mission ? Mais,
c’est les mains vides que M. Trazié et ses collaborateurs travaillent.
Recroquevillés dans leur bureau, l’un des mieux lotis, ces fonctionnaires
sociaux ne comptent que sur l’apport des structures externes pour s’occuper des
patients. Le maigre budget
de l’hôpital ne leur permet pas de travailler convenablement. Malgré ces
problèmes, les malades sont de plus en plus nombreux avec l’arrivée des
« de-par-la-loi », c’est-à-dire les malades conduits à l’hôpital par
les mairies, les policiers et les gendarmes. « Tous les patients ici sont des cas
sociaux. Mais nous ne pouvons pas les prendre en charge pour manque de
moyens », avoue impuissamment Trazié. Pire, les parents ne
facilitent pas les choses. « Les parents ne nous aident pas du
tout. Ils se débarrassent des malades en nous les confiant. Et nous n’avons
plus de leurs nouvelles ».
Avec les éducateurs spécialisés, c’est le même son de cloche, le
manque de moyens. La salle d’ergothérapie pour les jeux et les sports
n’existe que de nom. Pourtant, « à
travers ces activités saines, les malades mentaux
extériorisent certaines aptitudes ». Le spécialiste
Kouadio Raymond ne dispose que d’un damier et de quelques pots de peinture. « Insuffisant », lance-t-il.
Notre dernière escale est réservée à la « clinique
VIP », où sont logées les personnes nanties. Mais, pour des raisons non
élucidées, nous n’avons pas eu accès à ces privilégiés. Toutefois, à en croire
les habitués, ce pavillon comprendrait 6 chambres climatisées.
A l’issue de la visite, nous ressortons de l’hôpital, laissant
derrière des hommes et des femmes exposés aux nombreuses crises des patients à
qui ils tentent de donner un peu d’espoir. Les regards admiratifs des patients
traduisent bien leur volonté de sortir de cette « prison ». Mais, ils
sont contrains d’y rester. L’espoir placé en ce lieu se dissout peu à peu face
aux manques de moyens. La réalité est implacable : l’hôpital psychiatrique
est malade. Et si l’on n’y prend garde, il pourrait devenir « fou ».
Si tel était le cas, les patients internés envahiraient les rues…
Les causes des maladies (ENCADRE)
Un rapport de l’audit réalisé en juin 2010 à l’hôpital
psychiatrique de Bingerville, par Ahui Yedmel Paterne, juriste expert en Droits
humains, révèle que le trouble mental peut avoir plusieurs causes liées à
l’environnement dans lequel l’individu vit ou à des problèmes héréditaires. Ce
rapport présente la schizophrénie comme la première pathologie chez 35,25% des
patients. Suivent les
troubles de l’humeur (dépression 5,94%, psychose
12% et paranoïa 0,7%). Puis les troubles névrotiques liés au stress (1%), les
troubles mentaux organiques (épilepsie 1,31%), les troubles mentaux liés à
l’utilisation des substances (alcool 0,61% et toxicomanie 3,41%), les démences
(1,50% personnes du 3è âge) et les confusions (0,71%). Pour ce qui est des
autres pathologies comme le VIH, le taux est de 1,52%.
Toutes ces causes ont trois principales sources. La première est
d’ordre héréditaire (5%). Ensuite, vient la vie relationnelle. Et enfin, la
personnalité subjacente des patients.